« Alpha », de Julia Ducournau, se place dans un contexte d’épidémie simulant et esthétisant les effets de la propagation du sida dans les années 1980. Transmis par voix hématique, le virus ici présenté change ses hôtes en statues de marbre, entraînant une métamorphose mortuaire prétexte à la réalisatrice pour diffuser un lot d’images marquantes et déroutantes. Autrement, l’exécution d’ « Alpha » est particulièrement bancale, et cela est visible dès les premières minutes : musiques accompagnant systématiquement l’intensité dramatique d’une scène qui n’en avait nulle besoin, tendresse surinterprétée, décors expressionnistes surlignant grossièrement les intentions psychologiques des scènes, photographie marbrée déstabilisante et récit emberlificoteur au traitement scolaire jouant sur deux temporalités. Au vu des moyens employés, c’est un accident industriel pur et simple. Surtout que le film s’incorpore d’un grand nombre d’éléments dispensables, notamment un personnage de prof d’anglais campé par Finnegan Oldfield, qui ne sert qu’à expliciter les intentions du scénario à un stade où il fallait vraiment le vouloir pour ne pas les comprendre. C’était déjà un problème récurent dans « Grave » et « Titane » : Ducournau semble incapable de suggérer (ce qui est, faut il le rappeler, la base la mise en scène) ; pire, on dirait qu’elle se force presque à expliciter chaque élément, tout en nous plongeant paradoxalement dans un inconfort frontal via un montage expressif faussement désorganisé. Résultat, son film peine à trouver un ton harmonieux, et joue au funambule au dessus du chaos, s’adonnant volontiers à une caricature embarrassante de ses sujets (notamment le harcèlement scolaire et la saturation hospitalière).
Si « Titane » en appelait à « Crash » de David Cronenberg, « Alpha » ajoute « Carrie au bal du Diable » à la cartographie cinéphile de sa cinéaste : une héroïne anxieuse et éponyme, moquée dans son lycée pour ses effluves sanguinolentes, entretenant avec sa mère une relation chaotique, et des personnages retranchés dans leurs bulles. Évidemment, la malignité extraordinaire et le sadisme de Brian de Palma ne se retrouvent pas ici. La mise en scène d’« Alpha » est étonnamment faible, et fougueuse, elle ne cherche jamais à duper, à cacher, ou à manipuler. Elle cherche plutôt à ébahir, à performer. Manifestement peu confiante (en elle-même ou en ses spectateurs) Ducournau donne, voir jette aux spectateurs des indices grossiers pour se repérer dans ce dédales d’inquiétudes : changement d’étalonnage (les flash-backs sont nimbés d’un jaune pisse immodéré), changement capillaire selon les temporalités ; lorsque menace il y a, elle est toujours exhibée à l’avance ; lorsque l’héroïne fait face à ses angoisses, alors les angoisses doivent être grosses, et plus elles le sont mieux ça passe ! Ducournau se positionne dans une permanente recherche de l’image forte, celle qui va intensifier un paradoxe psychologique, un soulèvement graphique ou mettre en exergue une tension sociale. À force, ce stratagème devient si visible qu’« Alpha » peine à faire avancer son récit dans la limpidité qu’il souhaite manifestement atteindre. Pourtant, Ducournau parvient, parfois, à saisir une véritable émotion, notamment dans le segment final où les éléments s’assemblent avec une surprenante finesse. Toute l’énigme et la pathétique candeur de cette symphonie hystérique s’associe dans le plan final, un travelling s’achevant sur un gros plan d’Alpha, la survivante effacée. C’est à ce moment là qu’on se rend compte que nous n’étions pas enfermés dans des temporalités, mais dans des dimensions, dans des espaces mentaux, et que ce plan paraît comme une bascule dans l’imaginaire torturé de cette gosse bizarre. Avec cette ultime image, elle quitte le réel, et à ce moment, le film est prenant. Plus qu’une douleur, la maladie du film, jamais nommée, est un flot lacrymal d’incertitudes et d’angoisses, une névrose intolérable face à laquelle on préfère se changer en pierre, ou en mur. Si « Alpha » est incontestablement raté, si ses envolés empathiques et la grâce de son casting ne permettent pas de cacher les faiblesses de sa mise en scène et les facilités de son scénario, il donne pas moins envie de parler de lui, de parler d’elle, pendant des heures. Plus un mélodrame aux yeux rouges qu’un film d’horreur, et une œuvre excessivement chargée en ressources incurables. Rendez vous manqué.
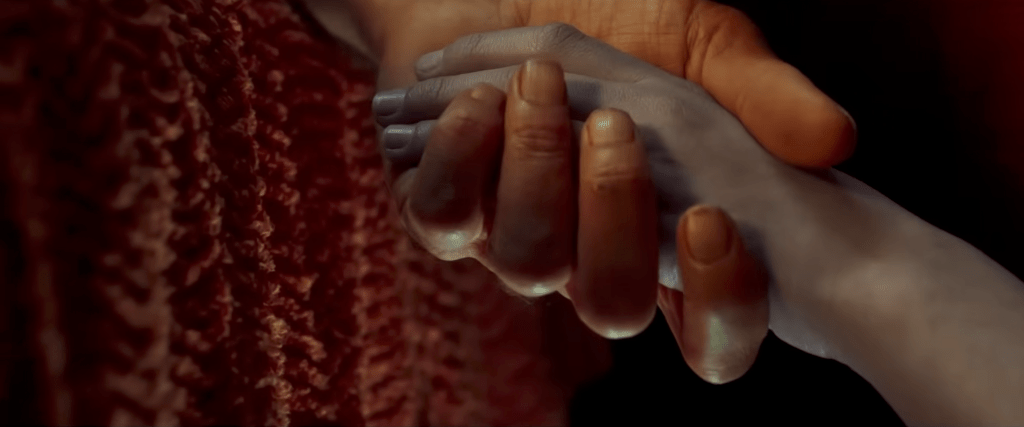
Laisser un commentaire