Par Boyen LaBuée.
Les films de la « Trilogie d’Oslo », « Rêve », « Amour » et « Désir », tous écrits et réalisés par Dag Johan Haugerud, peuvent être découverts dans n’importe quel ordre. En dehors d’un personnage récurent et de leur localisation serpentant au cœur de la capitale norvégienne, les films partagent peu. Même en terme narratif, certains sont moins linaires que d’autres. « Rêve » repose largement sur une voix-off, « Amour » est plus cacophonique, et « Désir » laisse l’impression d’un film silencieux. Dès l’introduction d’« Amour », prétextant la filature d’une visite touristique, nous sont présentées les sculptures ornant la façade de l’Hôtel de Ville d’Oslo. Souvent, ces sculptures montrent leurs sujets dans des postures aux significations qu’on qualifierait volontiers de tabous ou subversives, préfigurant l’ouverture affichée d’Oslo aux amours multiples ou à l’homosexualité. Cette scène pourrait sembler anecdotique, et pourtant elle pointe du doigt un aspect fondamental inhérent aux trois films : la banalité (quoi de plus conventionnel, dans une ville, que la façade d’une mairie ?), et ses nuances au sein desquelles s’enracine la singularité. Les trois films plantent leur excentricité dans un terreau routinier : « Rêve » se déclenche dans un lycée, à savoir l’ultime dédale du quotidien, « Amour » sur la ligne de ferry que prennent chaque jour ses personnages, et dans « Désir » c’est un simple pas de coté qui pousse les personnages à remettre en question l’identité masculine. D’ailleurs, de prime abord, rien de plus banal que l’introduction de « Rêve », de (trop) loin le plus beau et idiosyncrasique des trois, où se succèdent les plans de nuages sous couverts de la voix-off de l’héroïne. Celle-ci se garde bien de poétiser ces formes ni abstraites ni figuratives, mais elle les compare à des nids sentimentaux, rappelant la méthode des « loci », consistant à mémoriser des informations en les rangeant dans un lieu mental ; lieux représentés ici par ces petits ilots blancs caressant le ciel bleu. Le ton est donné : goût pour la forme littéraire, cartographie des parcours sentimentaux en milieu urbains, douceur de la banalité des choses, et récits réticulaires.

Paradoxalement à ce programme chargé, les personnages nous sont souvent présentés dans des positions confortables : assis, allongés, emmitouflés, bien au chaud. Nous les voyons donc majoritairement à des moments où ils ont le temps de songer à leur sexualité à l’occasion d’une lecture, d’un passage sur un ferry ou d’une simple balade : ces petits trains de vie bourgeois ne pensent qu’à ça, à leurs fantasmes, et à l’exploration de leurs désirs, facette que chaque film revendique ouvertement avec une impassible complaisance vis-à-vis de comportements que l’on jugerait volontiers déviants (dans « Amour », par exemple, un couple divorcé voit ses deux composantes continuer à vivre sur le même terrain, et il y a également des adultères, ou l’esquisse d’une relation intime entre un infirmier et son patient). Chaque individu relate donc une situation amoureuse donnant à la trilogie sa charmante pluralité, mais confinant parfois les films dans des carcans scénaristiques ramollissant leurs enjeux. Comme dans l’introduction d’« Amour » décrite ci-dessus, laquelle nous guide littéralement dans une catégorisation de plusieurs types de mœurs amoureuses, chacun des films va chercher en ces individus une façon singulière d’ébaucher, de dire, de vivre, de fragmenter le discours amoureux dans sa beauté ou son chaos. Si elle parvient souvent à incarner une véritable émotion, notamment en nous propulsant dans diverses façons d’explorer Oslo, la trilogie présente surtout une liste de personnages préétablis comme des repères moraux.

Le seul à tirer une véritable épingle, le seul foulant des sentiers encore jamais explorés chez d’autres auteurs interrogeant la sexualité dans la fiction, d’Eric Rohmer à Woody Allen en passant par Emmanuel Mouret ou Ryusuke Hamaguchi, c’est « Rêve ». Habile conte déjouant le drame queer au profit d’une histoire taillée dans l’adversité et la contradiction, c’est aussi des trois le plus impur et pervers, et donc forcément le plus attrayant cinématographiquement. Ce dernier, plus que les autres, est l’histoire d’un amour amoral et inassouvi, soufflé par les normes sociales et jouant sur leurs aspects pour donner du relief à une choralité maitrisée avec une précision digne de l’horlogerie suisse. Le film étudie tout ce qui passe dans son champ, en permanence : sociologie des corps, naissance du désir, sentiments incontrôlables, culpabilité, rejet, mensonge, introspection, merveilles et confusions. On se croirait presque à lire du Juni’chirō Tanizaki, et ce film-roman, pour ne pas dire ce journal intime filmique, où chaque scène affronte et interroge la précédente, regorge d’ambiguïtés, d’enchevêtrements psychologiques, et aussi d’une cruauté parfois brutale. Lorsque l’héroïne montre à sa grand-mère le manuscrit qu’elle a écrit à la suite de sa première histoire d’amour avec sa professeur de français, alors l’aïeule est comme esseulée. Les émotions décrites par sa petite fille éveillent en elle l’intensité dévorante de ses regrets et de son isolement due à la vieillesse, et Dag Johan Haugerud traite sans pathos cette cruauté inavouable, la regardant de l’intérieur en prenant comme motif l’image allusive et redondante d’un escalier sans fin glacé par l’hiver. Désordonné, « Rêve » traite du sentiment amoureux avec une limpidité sidérante, une sensibilité à l’image, au montage et au dialogue empoignante et saisissante, sans parler de la précision liée à la modestie hors-norme de son exécution. Tissé comme une suite de blocs narratifs, de confidences et de regards croisés, le film trouve presque miraculeusement une harmonie dans cet entrelacement des attentes familiales et des dynamiques sociales, entre les serrures et les clés constituant ces individus. C’est aussi un film fragile (comme les deux autres) et redoutable (bien plus que les deux autres) se déguisant volontiers en cauchemar labyrinthique.
D’apparence studieuse et discrète, cette trilogie révélant un cinéaste-romancier au style remarquable confronte autant qu’elle conforte, travaillant une mélodie narrative et visuelle que l’on se plait irrémédiablement à retrouver, croquant des personnages mâchés en profondeur, des kebabs aux cafés bobos, des bourgades excentrées aux tours des nouveaux quartiers ultra-modernes. Chaque scène se révèle alors comme un film dans le film, et on est ravi de rencontrer chacune d’entre elles et chacun d’entre eux, surtout quand on peut mêler et démêler à loisir chacun de ces entrelacs.

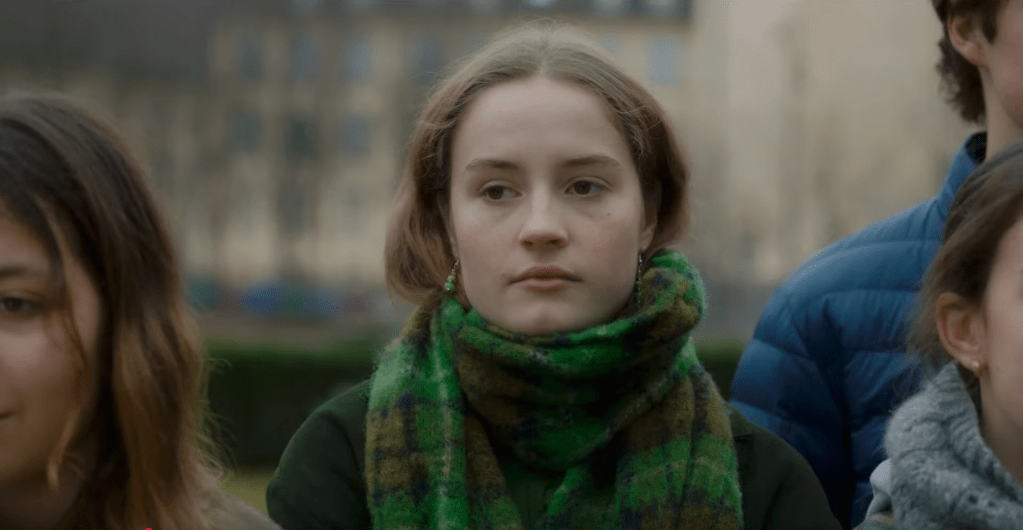
Laisser un commentaire